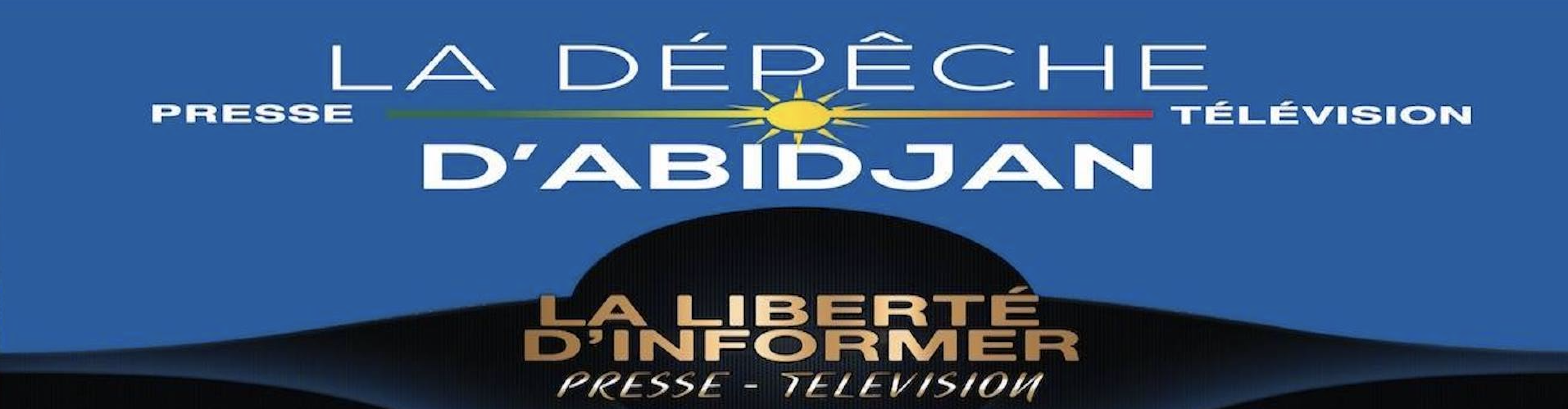Libanais, Américains, Chinois… Qui détient les terres en Afrique ?
Ces investissements, dont le pic survient peu après la crise alimentaire de 2008, sont souvent perçus par les pays hôtes comme un levier pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, développer, industrialiser leur agriculture et diminuer la pauvreté.
En principe, ils s’accompagnent de recettes fiscales significatives – cependant difficilement quantifiables, car les accords de concessions ne sont pas rendus publics – et de créations d’emplois nationaux. Cette obligation est mentionnée dans 15 % des contrats signés sur le continent selon l’ONG Land Matrix.
Un impact très variable
Dix ans après la vague, l’impact de ces investissements est très variable. Nombre d’entre eux ont été rentables et se sont accompagnés d’engagements positifs auprès des communautés (offre de pâturages, formations, transfert de savoir faire, possibilités de travail permanent et décent etc.).
Néanmoins, la faiblesse du droit foncier et les choix politiques d’autres pays ont facilité des acquisitions à grande échelle, ce qui a conduit, dans certains cas, les exploitants locaux à quitter leurs terres entraînant plus de cinquante conflits, selon le recensement de l’ONG.
Ces concessions, signées pour une durée moyenne de trente ans, peuvent également avoir des conséquences sur l’environnement : de l’usure des sols à long terme – quand les cultures sont intensives – à la déforestation massive, notamment dans le Bassin du Congo.
Lire la suite sur jeuneafrique.com
Sun, 25 Apr 2021 20:56:00 +0200
0