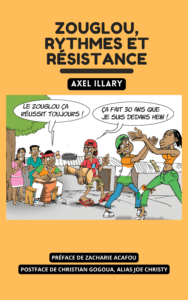La religion – Extrait de Visions et perceptions traditionnelles (Source : Introduction à la culture africaine) – Par Honorat AGUESSY

On ne saurait nier, par rapport aux domaines des jeux, des proverbes, de l’art, la place prépondérante qui revient au domaine de la religion dans la saisie du proprium africain eu égard aux « visions et perceptions traditionnelles ».
La religion africaine est, en un certain sens, l’effet et la source de la civilisation de l’oralité (38).
A défaut de livrets consignant les acquis des cultures africaines, c’est la religion qui joue le rôle de substitut vivant. Les pratiques religieuses conservent et traduisent le rapport au monde de l’homme africain. Elles expriment, dans le jeu du prescrit et de l’interdit, du permis et du défendu, les valeurs et contre-valeurs de la société.
Le domaine religieux est d’une richesse considérable. Pour nous en tenir à ses aspects essentiels susceptibles d’éclairer le sujet que nous examinons, commençons par noter qu’il comporte de véritables écoles de préparation, non seulement du fïdèle, mais aussi du simple citoyen. Ces écoles sont ce qu’on appelle habi- tuellement l’initiation.
En dehors de l’école que constitue la vie quotidienne familiale et sociale qui enrichit l’expérience de l’individu, l’initiation représente une institution capitale pour l’information et la formation du citoyen. C’est par elle qu’il a accès aux catégories végétales, minérales, animales, humaines, telles que chaque société se les repré- sente dans son langage. C’est elle qui lui permet de dépasser la connaissance vulgaire des valeurs auxquelles la société tient, en approfondissant leur pourquoi. Ainsi, le citoyen n’est plus un errant (un alzé comme disent les Fo), mais devient un homme complet, épanoui, connaissant le commencement de la production des valeurs et institutions ou peut-être aussi leur origine.
La tentative de définir l’origine s’opère par le mythe (parole par exemple) qui n’est pas le discours faux ou soutenu par l’intention de tromper autrui, mais le discours fondamental fondant toutes les justifications de l’ordre et du contrordre sociaux. Ainsi, celui qui a accédé aux dévoilements ou révélations que prodigue l’initiation n’est plus un simple fïgurant; on dit de lui, chez les F6 par exemple, qu’il a « l’oreille percée » (e to to).
Mais l’initiation ne procure pas tout le savoir dans le cadre d’une (cérémonie de durée limitée; elle se poursuit par un enrichissement moral, scientifique, politique, que seul le temps prodigue, et qu’il prodigue uniquement à l’homme persévérant. C’est un effort constant débouchant sur un style de vie, une attitude vis-à-vis de la vie, de la société et de l’univers, et qui ne se réduit pas à l’acquisition d’un certain nombre de recettes.
Voilà pourquoi nous dirons que le savoir prodigué par l’initiation relève de l’ordre qualitatif et non quantitatif: il s’agit d’apprendre à bien vivre et non de capitaliser des connaissances.
Quelques témoignages de savants pourraient compléter cesremarques. A propos du Koumen, A. Hampâté Bâ et Gi. Dieterlen écrivent : (( L’initiation est connaissance : connaissance de Dieu et des règles qu’il a instaurées; connaissance de soi, aussi, car elle se présente comme une éthique; connaissance également de tout ce qui n’est pas lui (39). » Et cette science doit atteindre l’universel, chacun de ses éléments et de ses aspects faisant partie d’un tout. Les Peul disent : « Tout ne se sait pas. Tout ce qu’on sait, c’est une partie de tout. o (( L’initiation, dit un texte peul, commence en entrant dans le parc et finit dans la tombe. »
Pour bien comprendre cet aphorisme, il faut savoir que ((la vie d’un Peul, en tant que pasteur initié, débute avec 1’ H entrée D et se termine par la « sortie » du parc, qui a lieu à l’âge de 63 ans. Elle comporte trois séquencesde 21 ans chacune : 21 ans d’apprentissage, 2 1 ans de pratique et 21 ans d’enseignement B.
<( Sortir du parc )) est comme une mort pour le pasteur; il appelle alors son successeur: le plus apte, le plus dévoué des initiés ou son fils. Il lui fait sucer sa langue, car la salive est le support de la ((parole D, c’est-à-dire de la connaissance, puis il lui souffle dans l’oreille gauche le nom secret du bovidé.
Plus loin, un détail important : <(33 degrés correspondent aux 33 phonèmes de la langue peu], plus 3 degrés supérieurs qui sont inau- dibles; ils sont ceux de la Hparole non formu- lée D, mais toujours présente, dite (( de I’incon- nue » (40). ))
Ce témoignage fait entrevoir le rôle irrempla- çable de l’initiation, excellente école qui éduque chaque citoyen non seulement en lui enseignant les connaissances techniques requises par son métier, mais aussi en l’instruisant de la structure de l’univers, de ce que l’homme peut espérer et de ce qu’il peut faire.
Un texte basa (41) (Cameroun) vante les mérites d’une telle éducation et développe des idées sur la conception basa de l’homme : GL’homme est comme un arbre, il naît droit et ne se courbe que plus tard sous le poids des vents de ce monde. Tout comme l’arbre, on peut le redresser quand il est encore jeune. De même qu’un vieux tronc tordu ne peut plus être redressé, de même, un adulte vicieux est difficile- ment redressable. L’enfant naît exempt de tout vice. Cependant, son innocence disparaît au fur et à mesure qu’il grandit et qu’il apprend toute chose. Après qu’il a pris conscience de lui- même, il découvre: le monde qui l’entoure et qui agit sur lui. Par sa curiosité et son goût de l’aventure, il découvre très tôt le mal. Or, à cet âge il n’est encore prévenu de rien. Sesaînés, qui ont avant lui une expérience de la vie, ont le devoir de l’instruire, afin qu’il puisse éviter le mal et rechercher le bien. L’éducateur est à la fois comme arbitre et entraîneur. Lui-même n’est pas nécessairement bon joueur. Mais il connaît toutes les règles du jeu, de telle sorte qu’il peut les apprendre à d’autres et les obliger à s’y conformer. »,
La morale ainsi enseignée à l’éduqué par l’éducateur ne prend toute sa valeur en tant que parole respectable et impérative que dans le cadre des pratiques religieuses où tout baigne dans le sacré.
Voilà pourquoi, en prospectant le domaine religieux, on mettra au jour des mines d’idées sur les (( visions et perceptions traditionnelles H.
C’est en interrogeant les théologies et cosmologies élaborées dans les cénacles qu’on se rendra compte, comme Marcel Griaule, que la connaissance dogon, par exemple, est (<compo- sée de 22 catégories de 12 éléments, soit 264, dont chacun est la tête de liste de 22 couples… cette construction de 11616 signes exprime tous les êtres et toutes les situations possibles vues par les mâles. Celles des femmes, de même importance, lui correspond ». On verra aussi que les Dogon ou d’autres Africains «‘ont construit uneexplication indigènedesmanifesta- tions de la nature (anthropologie, botanique, zoologie, astronomie, anatomie et physiologie) comme des faits sociaux (structures sociales, religieuses et politiques, techniques, arts, écono- mie, etc.) (42) )).
Le domaine religieux nous révèle d’autres caractéristiques de la conception qu’ont les Africains de l’univers, de la vie, de la société.
C’est ainsi que le traitement du corps, qui intervient dans le rapport de l’homme avec la divinité, prouve l’inadéquation de la pensée religieuse dualiste, où le corps est éliminé au profit de l’esprit. Les techniques du corps jouent une fonction si importante que c’est plutôt par le corps que se manifeste la divinité. Celle-ci n’est pas uniquement un objet de démonstration à travers l’affrontement des écoles théologiques. Elle est une manifestation jouée dans l’allégresse
collective et non la conclusion d’un syllogisme. Dans l’unité corps-esprit, individu-collectivité, recueillement-allégresse, vénération-familiarité, c’est l’homme total lié à la société qui manifeste la divinité en assumant. et sublimant tout ce qui le constitue comme homme.
Une autre remarque s’impose ici : elle concerne la multiplicité des noms que peut avoir un Dieu. C’est un piège où tombent souvent ceux qui ont toujours hâte de découvrir le polythéisme par- tout ailleurs qu’en Europe. Ils voient dans la multiplicité des noms d’un Dieu la confirmation de leur préjugé. Or, en situant ce mode de nomi- nation de la divinité dans le cadre culturel de l’oralité, on comprend mieux l’attitude en cause.
En effet, dans ce cadre, la prolifération des noms d’un être — homme, dieu, etc. -, est un signe soulignant son importance. L’enfant obtient dès sa naissance plusieurs noms : nom secret, nom courant, et d’autres noms lui sont attribués ultérieurement, consignant les étapes importantes de la. vie. La prolifération des noms de l’individu traduit ia constellation des désirs de ses parents, de lui-même, de sa liaison mythique avec les ancêtres, de sa position familiale, de la manière dont il est venu au monde (la tête la première, ou les pieds les premiers, ou le cordon ombilical autour du cou, etc.), des péripéties de son idiosyncrasie, etc.
La prolifération des noms de la divinité est à comprendre dans cette optique. Donner plu- sieurs noms à la divinité ou à Dieu est la meilleure manière de chanter sa gloire et sa puissance.
Ici encore la divinité ne se démontre pas, elle est nommée. On voit par là comment une étude qui, considérant la prolifération des noms d’une divinité, conclurait au polythéisme, s’engagerait sur une fausse piste.
Le mythe.
Comme nous l’écrivions plus haut, le mythe n’est pas le discours faux ou soutenu par l’intention de tromper autrui, mais le discours fondamental, fondant toutes les justifications de l’ordre et du contrordre sociaux.
Si nous abordons son examen après avoir traité du domaine religieux, c’est parce qu’il n’est pas sans rapport avec le religieux. En ce sens, il nous faut distinguer les différentes catégories de récits.
Ceux qui emploient indifféremment les mots fables, contes, légendes, mythes, ne peuvent pas appréhender le statut spécifique du mythe et ce qu’il nous apprend sur « les visions et perceptions traditionnelles » touchant la conception du monde des Africains.
M. Léopold Sédar Senghor s’est efforcé d’apporter de l’ordre dans ces emplois indifférenciés des mots désignant diverses catégories de récits. Malheureusement, il n’a analysé que la comparaison entre conte et fable. Selon lui, le conte suppose un récit sans mise en scène des animaux, tandis que la fable fait intervenir les animaux comme Principaux acteurs du récit.
Nous aurions aimé savoir dans quelles conditions il souhaiterait qu’on emploie le terme de mythe. De plus, on peut se demander si la distinction qu’il fait entre conte et fable est opératoire dans le contexte africain.
La présence ou l’absence d’animaux constitue- t-elle un critère déterminant dans le contexte culturel africain? N’y a-t-il pas d’autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que le jour, la nuit, la période de la journée où l’on raconte un récit?
Pour éviter l’impasse créée, dans le contexte européen, par de simples analyses conceptuelles des mots fable, conte, légende, mythe, il conviendrait d’étudier les mots qui désignent différentes catégories de récits dans la terminologie africaine.
Dans le livre de.Boilat (43) publié il y a plus d’un siècle (1853), nous lisons que : « Les Wolof appellent du nom de Laibe les proverbes, maximes, adages, énigmes et les fables propre- ment dites, parce que, des unes comme des autres, on peut déduire une leçon de morale.
« C’est ordinairement le soir, au clair de lune, devant l’entrée de leurs cases, ou assis sur le sable, au milieu de la place publique du village, quelesWolof racontent desfables.
<<Le conteur est placé au centre du cercle; il ne néglige rien pour amuser ses auditeurs, mettant en scène les hommes. les animaux, il essaye d’imiter leurs gestes, leurs grimaces et leur son de voix; il chante de temps en temps, et l’assemblée répète le refrain avec mille claquements des mains, accompagnés du bruit du tam- tam (…). Le conteur ne fait jamais la morale; c’est à l’auditoire à tirer ses conclusions. ))
Ici, également, nous aurions aimé savoir quel terme les Wolof de cette époque utilisaient pour désigner le mythe.
Considérons une aire culturelle africaine où les termes désignant les genres de récits sont plus nombreux. Il s’agit de l’aire culturelle FQ (Dahomey).
On y rencontre, dans le langage habituel, les mots X6, tà, XOjDxO, ysx0, XX& glu, huenùxo. Que signifient ces termes? De nombreuses précisions ont été données à ce sujet par d’éminents auteurs (44).
Pour notre part, nous tenterons de rendre opératoires des distinctions faites de façon diffuse dans le langage courant fi, (pris comme exemple), en mettant en relief les caractéristiques du mythe.
X6 voudrait dire « histoire, événement, nouvelle » ; tâ « histoire vraie concernant le passé familial »; x6@ <(récit historique datable »; ~EXO« conte de fées »; glu « conte, fable, anecdote »; xcxd « conte », tandis que huenùx$ signifierait (provisoirement) <(récit vrai ou légendaire »(45).
En reprenant ces termes pour approfondir l’emploi vulgaire qui en est fait, en nous posant certaines questions (à quelle période de la
journée se dit telle ou telle forme de récit? Qui dit ou raconte ce récit‘? A qui est raconté le récit? Quand intervient l’exigence ou le critère de vérité et de fausseté?), nous parviendrons à repérer le statut du mythe et à préciser les enseignements qu’il comporte.
Le terme indigène huen2x conviendrait pour désigner le mythe :Le mythe (huenUx6) peut être raconté à n’importe quelle période de la journée. Il est en revanche soumis à des restrictions à deux niveaux : au niveau de ceux qui sont susceptibles de recewoir le messagecommuniqué d’une part, au niveau de ceux qui sont habilités à réciter ou réactualiser le message,d’autre part.
En ce qui concerne la première restriction, if est établi que n’importe qui ne s’entend pas réciter le message par le spécialiste. Pour la seconde, disons qu’il s’agit de spécialistes en matière de pratiques religieuses (tout au moins dans le système de (divination).
Une autre caractéristique du huenùxb (mythe) consiste en ce qu’il est absurde de considérer, à son propos, les catégories du vrai et du faux. Ici intervient le principe d’autorité et de relation de solidarité efficiente entre le locuteur et l’interlo- cuteur.
Dans le mythe, il s’agit pour un fidèle de prendre connaissance du récit fondateur qui permettrait d’élucider un problème existentiel angoissant.
Dans ce climat de relation de solidarité efficiente, la parole se manifeste comme acte. La voix pose, dans un contexte symbolique, le problème de la réalité en tant qu’objet considéré ici, maintenant, entre locuteur et interlocuteur.
Dernière caractéristique du mythe cfo du moins) : le spécialiste ne le récite pas par simple amour du bavardage et par souci de divertisse- ment; il attend de la récitation que son auditeur en tire la leçon qui s’impose, qu’il suive la voie qu’implique le récit et obtienne satisfaction.
En d’autres termes, le mythe tire à consé- quence, dans la mesure où l’auditeur-consultant est contraint par les conclusions sur lesquelles débouche le récit.
Tel est le huenùxQ (mythe), que de nombreux signes distinguent du tâ (récits historico- mythiques), du xex0 (conte de fées), du glu (anecdotes portant sur n’importe quel sujet de la vie), etc.
Si toutes ces formes de récit ont en commun de n’avoir pour fondement que la parole (mq’- thos), il est cependant important de souligner que seul le huemi@ prend toute son efficacité dans la parole.
On ne peut manquer de penser ici à Pavlov, selon qui la parole (<entre en rapport avec toutes les excitations externes et internes qui arrivent aux hémisphères cérébraux, les signale toutes, les remplace, et, pour cette raison, peut provoquer les mêmes réactions que celles susci- téespar cesmêmesexcitants (46) ».
Le concours de la voix, du geste et du rythme confère à la parole récitant le mythe et à la parole-message émanant du récit une force et un statut tels que le mythe (huenùxb) (47) n’a en un sens rien à voir avec l’aspect purement ludique et divertissant des autres formes de récit conçues par la théorie indigène.
Pour nous faire comprendre en un autre langage, nous dirons que le mythe africain (même s’il dissimule leur science et leur pouvoir « dans le pli des haillons dont ils sont affublés ») relèvedel’ordre dusymbolique.
L’ordre du symlbolique, tel que nous l’entendons, se distingue de l’ordre de (( l’imaginaire N et de l’ordre du <( réel D, pour reprendre le langage de l’École freudienne de Paris.
Pour M. Jacques Lacan(48), chef de cette école psychanalytique, le symbolique est ce qui donne sens à l’imaginaire et au réel. Il y a (( autonomie de symbolique D, (Cprise du sym- bolique D sur l’imaginaire et le réel, (( supréma- tie du symbolique » sur l’imaginaire dans la mesure où aucune formation imaginaire n’est spécifique, où H alucune n’est déterminante ni dans la structure, ni dans la dynamique d’un processus )).
Le symbolique représente l’ordre ou l’organisation constitutive, la chaîne qui prend l’homme dès avant sa naissance et au-delà de sa mort ». Il est contraignant et permanent par rapport à l’imaginaire constitué par les formes successives ou les manifestations habituelles et non permanentes du symbolique qui produit le réel.
A la lumière de cette trilogie qui peut être utile pour situer la catégorie de récit dont relève le mythe (huenùx4) par rapport aux autres catégories de récit (tâ, glu, xcxQ, etc.), nous pensons que le caractère fondateur du mythe, son caractère de donateur de sens aux réalités quotidiennes et aux contenus des autres formes de discours, doivent être fortement affirmés ici.
C’est compte tenu de ces caractères que le domaine du mythe est lié à celui de la religion, dans le cadre d’une culture à dominante orale où les valeurs sociales prioritaires sont nimbées d’une aura de religiosité.
De nombreux récits de divination qui portent sur la création du monde, l’instauration de l’ordre, le statut de l’homme dans l’univers, la justification de tel ou tel principe moral et des différents ressorts de la société, la manière de bien vivre, peuvent, au terme de cette élucida- tion, être appelés des mythes. Ils se situent au- delà de toute éventuelle volonté de tromper pouvant émaner du locuteur, dans la mesure où cet hypothétique trompeur baigne dans l’ordre justifié par ces récits, tout comme son interlocuteur y est pris.
Le mythe africain n’est pas un discours 202 consciemment trompeur. Compte tenu des thèmes variés qu’il aborde, nous pensons qu’il livre, au niveau de la parole, les idées maîtresses concernant la conception du monde des Africains, idées que l’on peut comparer à celles qui se dégagent des autres domaines d’investigation : les jeux, l’architecture, la chorégraphie, la musique, l’urbanisme, sans oublier les devinettes, les proverbes et les fables.
Dans tous ces domaines de prospection de la pensée africaine, un trait demeure permanent : le (( mi-dit » du discours verbal, gestuel, artistique et ludique.
Le discours qui porte la pensée dans toutes ses manifestations ne va pas, d’un trait, jusqu’au bout de l’élucidation de ses implications. II appelle une participation de l’interlocuteur ou de l’observateur-auditeur. Soit qu’il tente dans le mythe, malgré la longueur du récit, de <(dérober aux profanes une précieuse fécule qui, elle, semble bien appartenir à un savoir universel et valable », soit qu’il s’efforce dans les proverbes, en dépit de leur caractère condensé, de tout livrer à l’interlocuteur, tout en provoquant son intervention, soit que, enfin, il se joue ou s’implante dans l’espace sans explication, le <<mi-dit » en dit a:ssezsur les principes essentiels de la société à laquelle nous avons affaire. Il s’agit d’une société où l’univers et la vie ne sauraient être assumés par l’individu réduit au solipsisme. L’ (( autre » est toujours impliqué et interpellé dans ce qui conditionne, sinon détermine ensemble le <(je », le <(nous )) : l’antériorité ou tout au moins la simultanéité de la communauté dès que le«je»surgit.
C’est cette dimension prioritaire que le mythe théorise dans le langage fondateur qu’il repré- sente. Dégager de ces différents domaines les visions et perceptions traditionnelles africaines est bien plus instructif que d’examiner les déclarations et états d’esprit de tel ou tel penseur acceptant ou niant l’existence d’une philosophie africaine.
Au total, toutes les philosophies ne sont-elles pas faites de visions et de perceptions plus ou moins bien articulées et à travers lesquelles se traduit le phantasme d’un groupe ou d’un individu?
S’il est légitime d’admettre les pensées interprétatives du monde, pensées souvent brillantes mais quelquefois délirantes, dont la société ne sait que faire dans sa tentative pour transformer le monde, n’est-il pas aussi légitime de prendre en considération des pensées à l’œuvre dans la transformation du monde et dans les différentes activités quotidiennes ? Les voix de manifestation de la logique et de la pensée sont d’une riche variété; il nous faut éviter tout dogmatisme paresseux en nous efforçant de les assumer toutes.
Par Honorat AGUESSY
Source : Visions et perceptions traditionnelles (Source : Introduction à la culture africaine)
0