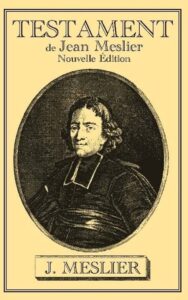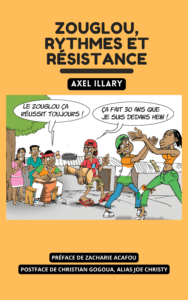Ernesto Djédjé, 30 ans déjà : Retour sur le parcours d’un artiste peu ordinaire

C’est en 1947, à Tahiraguhé, dans la région de Daloa, que naît Ernest Djédjé Blé Loué. Son père, un certain Touré, est un homme d’affaires originaire du Sénégal. Sa mère, Dapia Blé, fonctionnaire de l’église baptiste «œuvre et missions» est Bété. Très tôt, Touré abandonne son fils pour émigrer en République Centrafricaine, pour devenir, aux côtés, de l’Empereur Bokassa, Imam de Bangui. Le jeune Ernest grandit donc avec sa mère et son oncle Blé Loué, dont il portera finalement le nom à l’état-civil. Très vite, il développe de bonnes prédispositions pour le chant et la danse et s’attire la sympathie des chansonniers de Tahiraguhé. A 10 ans, Ernest Djédjé est initié au «Tohourou», un rythme du terroir bété, qui lui permet de s’aguerrir au chant. A 16 ans, il monte, avec son «pote» Mamadou Konté, «Les Antilopes», un orchestre de fortune. Au sein de cette formation, il s’outille au maniement de la guitare. Et le groupe se produit à Daloa et ses localités environnantes. En 1965, Amédée Pierre le remarque à Vavoua, et l’enrôle aussitôt dans son orchestre «Ivoiro-Star». Il en devient rapidement le chef, et y apprend à jouer de la guitare métallique. Mais, le jeune homme nourrit de grandes ambitions. En 1968, son BEPC en poche, Ernest Djédjé choisit de partir pour la France. A Paris, il étudie l’informatique, puis rentre en Côte d’Ivoire où il est recruté comme responsable culturel à l’ARSO (Autorité pour l’aménagement de la région du sud-ouest) à San Pedro. Avec l’aide d’Emmmanuel Dioulo, son pataron, il monte le « San-Pedro Orchestra », avant de regagner la France. Un artiste complet et un gros travailleur Et en 1970, il enregistre son premier album intitulé «Anowa», un 45 tours, mélange de soul, rythm & blues, et de jerk dance. Les arrangements sont assurés par Manu Dibango. C’est le début de sa marche vers la gloire. Entre 1970 et 1973, Ernesto Djédjé enchaîne les œuvres musicales «N’wawuile/ N’koiyeme», «Mamadou Coulibaly», «Zokou Gbeuly»… au total, six disques qui connaissent tous un franc succès en Côte d’Ivoire. Et en 1973, précédé d’une belle réputation, il rentre au pays. Dans sa tête, il sait ce qu’il veut : révolutionner la musique ivoirienne. Ernesto Djédjé mêle donc habilement disco danse, rumba, makossa et musique du terroir bété. Il accentue ses recherches dans la tradition et signe, en 1975, «Aguissè», l’album dont le titre-éponyme devient une chanson culte.
Avec le producteur Raïmi Gbadamassi dit Badmos, il part à Lagos, au Nigéria, et y découvre l’afrobeat de Fela Anikulapo Kuti, savant dosage de sonorités yoruba, funk, jazz et highlife. Séduit, Ernesto Djédjé décide de le mêler aux chants lyriques du «tohourou», ainsi qu’au disco et à la percussion traditionnelle de Côte d’Ivoire. Cette rythmique nouvelle, qu’il vient de créer, est baptisée Ziglibithy. Sous la houlette de Badmos, Ernesto Djédjé sort en 1977 son premier 33 tours, une œuvre enregistrée à Lagos qui s‘intitule « Ziboté ». Le succès est phénoménal aussi bien en Côte d’Ivoire que dans la sous-région. Ernesto Djédjé devient dans la foulée avec son ziglibithy, le « Gnoantré (épervier en bété) national». Peu après, celui qui vient d’être élu meilleur musicien de l’année par ID crée «Les Ziglibithiens». Diabo Steck est à la batterie, Bamba Yang au clavier et à la guitare. Dans ses rangs, l’orchestre compte aussi des noms comme Léon Sina, Eugène Gba, Yodé, Tagus, Assalé Best, Abou et Youbla. Sans oublier John Mayal, qui deviendra Yalley, qui fait office de danseur auprès d’Ernesto Djédjé. Avec ce groupe composé de musiciens talentueux, il sort l’album Les “Ziglibithiens” en 1978. L’année suivante, il met sur le marché « Golozo » et, en 1980, «Azonadé ». En 1981, c’est l’album «Zouzou Palegu» qu’il jette dans les bacs. Douze plus tard, il sort «Tizeré », avec le titre « Konan Bédié» en hommage à cet illustre homme politique et une autre, dédiée au président Félix Houphouët-Boigny, intitulé «Houphouët-Boigny Zeguehi». Ce sera son dernier album…
De l’avis de plusieurs musicologues, Ernesto Djédjé était complet : génial auteur-compositeur-interprète, talentueux instrumentiste, danseur hors pair. Il savait tout faire et en plus, il le faisait bien. Très bien même. Sur scène, il était tout simplement époustouflant. Avec son pantalon «patte d’éléphant», ses souliers en cuirs brillants et surtout ses déhanchés qui déchaînaient les passions lors de ses prestations. Enfin, Ernesto Djédjé, avec son 1,98m pour 95kg, était un forçat du travail, qui ne s’arrêtait que quand il pensait avoir atteint la perfection. C’est cela aussi la marque des grands artistes. «Le génie, c’est 80% de travail et 20% de hasard », disait Oscar Wilde. Cela, Ernesto Djédjé l’avait bien compris…
In Le Patriote
Fatim Djédjé, fille d’Ernesto Djédjé: “On m’appelait photocopie de papa »
30 ans après la disparition de Loué Blé Djédjé Ernest alias Ernesto Djédjé, nous avons retrouvé une de ses filles, à Paris. Elle se prénomme Fatim. Et sa mère est une Sénégalaise. A côté de l’histoire du ‘’Gnoantré’’ avec la musique, il y a ses histoires avec les femmes. Parmi celles-ci, il y a bien sûr la belle égyptienne Lola Moustapha Soher Galal (à qui il a dédié la chanson ’’Lola’’). De leur rencontre sont nés Tarek et Dounia. Djédjé a connu une autre femme, la Sénégalaise Rokia Lo. Avec elle, il a eu une fille: Fatim Djédjé, actuellement étudiante en communication à Paris. A l’occasion de l’anniversaire de la mort de ce monument de la musique, Top Visages a causé avec Fatim.
Quel a été le sentiment qui t’a animé lorsque je t’ai demandée de m’accorder cette interview à l’occasion des 30 ans du décès de ton père ?
– C’est à la fois un sentiment de tristesse et de joie. Tristesse parce que cela va me rappeler la mort de papa; et joie parce que c’est la preuve qu’il y a une population qui est encore attachée à lui et cela me touche profondément.
• Que ressens-tu en écoutant les chansons d’Ernesto Djédjé ?
Regrets, sentiment de n’avoir pas partagé quelque chose de beau avec lui ?
- Très franchement, étant née en 79, j’étais encore très gamine malheureusement lorsqu’il est mort. Car je ne vous le cache pas, la présence d’un père pour une fille est primordiale. On parle de complexe d’Œdipe (rire). Les choses se sont faites à plusieurs étapes. Au début, j’avais beaucoup de mal à l’écouter ou à entendre parler de lui. Ça me gênait, c’était beaucoup de tristesse. Les gens étaient heureux de parler de lui en ma présence, mais ils ne se rendaient pas compte de la souffrance qui était mienne. Pendant longtemps, ça a été très douloureux dans ma vie et aussi celle de ma mère (Rokia Lo : ndlr).
• On dit que ta mère était très discrète dans sa relation avec ton père ?
- Oui, c’est une douleur dont elle n’a jamais fait le deuil. Elle tenait le ’’Rokilo’’, un des restaurants africains les plus prisés de la place parisienne. Mais à aucun moment, elle faisait sortir le nom de mon père dans ses échanges avec ses clients et même avec ceux qui savaient qu’elle a partagé un moment de sa vie avec papa.
• Elle devrait pourtant en être fière ?
- Je pense qu’elle a voulu me protéger. Elle a été très bouleversée par la mort de papa, car elle m’a eue très jeune, à 20 ans. Cette douleur fait qu’elle n’a jamais voulu rien revendiquer. J’en veux pour preuve le fait qu’elle ait cédé sa part d’héritage à ma grand-mère Dapia, la mère de papa. Elle se disait que c’était une vieille dame qui avait plus de besoins. Et que, quant à elle, elle pouvait se refaire parce que jeune. En gros, on parlait peu de mon père dans mon entourage, même si, parfois, certaines personnes, pour je ne sais quelle raison, l’évoquaient sachant que maman s’y opposait.
• Il fallait bien qu’on te parle de ton père…
– Petit à petit, je suis revenue vers cette partie de mon histoire. J’ai demandé que maman me parle plus de mon père. Elle l’a fait de façon évasive. Quelque part, elle avait encore en elle beaucoup de douleur après la disparition de papa.
• Elle n’a jamais fait le deuil ?
- En tout cas, elle ne le fait pas publiquement. C’est très personnel chez elle. A un certain moment, elle a senti ce besoin qui était le mien de retrouver mes racines. Et cela s’est passé un peu par coïncidence dans son restaurant. Là, j’ai croisé mon demi-frère Bouba… (Grand sourire). Je connaissais maintenant la réputation de mon père auprès des femmes…(Rire). Bouba m’a serrée fortement dans ses bras, au bord des larmes. Il m’a expliqué qu’on était ensemble lorsque j’étais petite à Abidjan. Lui, il vit à Bordeaux avec mes autres frères et sœur Tareck et Dounia.
• Bouba, c’est le fils de ta belle- mère Lola Soher Galal ?
- Non ! Sa mère est sénégalaise également. Avec Tareck et Dounia, ils ont tous grandi ensemble. Bouba m’a donc conviée à venir leur rendre visite. Cela a été une autre grande étape dans ma démarche de recherche de mes origines. Grâce à lui, j’ai fait un grand pas. J’avais donc besoin d’en savoir un peu plus sur mon père, ses parents, mes frères et les collaborateurs de papa. Il a été marié, il a eu une vie… j’avais envie de savoir tout cela.
• Quels sentiments as-tu éprouvés en retrouvant tes frères ?
- Ce fut un grand plaisir pour moi de rencontrer les autres enfants de mon père. Et c’est aussi une reconnaissance pour moi qui avais toujours été dans l’anonymat parce que ma mère voulait nous protéger. Même à l’époque du Président Houphouët, les gens lui demandaient de m’envoyer en Côte d’Ivoire, mais elle refusait. Elle a été très catégorique vis-à-vis de tout cela dans une dignité incroyable. Elle n’a pas voulu profiter de quoi que ce soit.
• Qu’est-ce que tes frères t’ont fait découvrir de ton père ?
Eux, ils ont de la chance. Ils ont plein de souvenirs, des photos avec papa. C’est une chance incroyable que je n’ai pas eue malheureusement. Mais j’ai son nom, sa reconnaissance sur mes documents officiels, car il m’a reconnue. C’est déjà le plus comportant. J’ai des souvenirs de mes tantes qui me racontaient qu’il s’occupait beaucoup de moi. Et on m’appelait «photocopie» du fait de notre ressemblance.
• Grâce à tes frères tu as eu une idée de ton père. Et musicalement, tu l’a découvert aussi ?
- Oui je l’ai beaucoup écouté. Déjà, je suis contente de tomber dans ce monde où, grâce à Internet, on peut découvrir des choses passées. J’ai vu de nombreuses vidéos de lui sur la toile. J’ai découvert qu’il a fait 14 albums. Je ne m’attendais pas qu’il soit aussi productif. Je suis fière parce que je vois qu’il était très en avance sur son temps. Je vois la modernité de sa musique. Je lui tire mon chapeau d’avoir fait, dans les années 70, une musique qui donne l’impression d’être faite de nos jours. C’est vrai qu’il avait un don, mais il avait la maîtrise de la technique musicale, il avait une très bonne base. En fouillant un peu partout, j’ai appris qu’il était très professionnel : il était structuré avec un orchestre ‘’les Ziglibithiens’’. Sincèrement, j’ai été bluffée lorsque j’ai découvert toutes ses qualités (sa voix devient triste).
• Tu deviens triste ?
- Le fait de n’avoir pas été à ses côtés et partagé toutes ces choses avec lui est le grand regret de ma vie. Et ça, je ne peux pas m’en cacher. On se dit comme tout le monde, ma vie aurait été différente à ses côtés. Mais, je ne vais tout de même pas me mettre une balle dans la tête. Il m’a laissé un héritage musical mais aussi cette gentillesse et cette gratitude que les gens ont vis-à-vis de lui… Je ne me plains pas.
Waïper Saberty, un des musiciens que Djédjé a initié au ziglibithy, me disait que le «Gnoantré» doit être célébré chaque année et qu’il mérite même un musée comme celui de Bob Marley en Jamaïque.
Oui. Avec ce que j’ai découvert de papa, je pense que Waïper a parfaitement raison. A ma décharge, je suis venue tardivement dans cette histoire. Ma démarche dans un premier temps est affective.
Là, il y a beaucoup de choses qui sont envisagées … ?
– Et au niveau musical, je pense qu’il serait intéressant que les héritiers musicaux de papa et même tous ceux qui croient en cette musique créent une sorte d’école pour former les jeunes artistes au ziglibithy. C’est un peu dans cette dynamique et je suis flattée par l’initiative de Blissi Tébil qui a créé le Centre Ivoirien pour la recherche sur la Musicologie Africaine. On m’a dit qu’on y fait des recherches sur la musique traditionnelle africaine, notamment le Ziglibithy. Blissi est en ce moment à Paris et je serais ravie de le rencontrer.
• Je t’ai sentie très réticente quand je t’ai appelée pour cet entretien. Tu me disais que tu ne savais pas quoi dire, parce que tu n’as pas connu ton père. Mais, finalement, tu as des choses à dire ?
- Oui, mais c’est vrai, ce n’est pas toujours évident de parler de soi, de son papa qu’on a peu connu. Il y a des gens qui l’ont plus connu que moi. Je me suis dit qu’ils étaient mieux placés pour parler de lui. Etant née en 79 et lui mort en 83, tu vois que je ne pouvais pas parler des émotions que nous aurions partagées. J’ai des souvenirs de mon enfance liés plus à ma grand-mère Dapia qu’à mon père. Et aussi ma grand-mère maternelle qui s’est beaucoup occupée de moi avant que je ne vienne en France. Mais bon, je n’ai fait que répondre aux questions que tu m’as posées, en fonction de ce que je ressentais. Je remercie tous ceux qui, chaque année, à cette période, se souviennent de papa. Grâce à eux, je sais qui il est. En particulier Top Visages, car dans mes recherches, j’ai eu beaucoup d’articles de votre journal qui parlaient de mon père.
In Top Visages
Sun, 07 Jul 2013 11:23:00 +0200
0