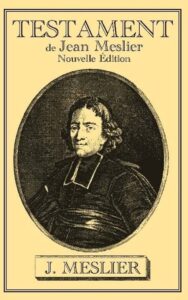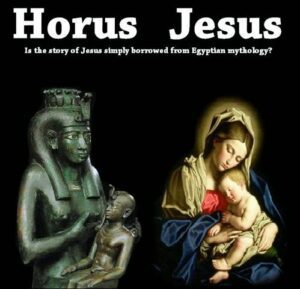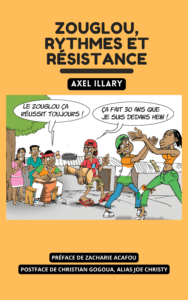Le christianisme en Afrique, héritage incontesté de la colonisation

« Vos ancêtres se sont vus imposés un culte venu d’ailleurs, le christianisme. Ils pratiquaient d’autres religions, et de façon parfois violente, on leur a imposé un culte imprégné de culture occidentale et méditerranéenne. Pour vous, ils étaient dans le tort, quand ils pratiquaient les anciennes religions ? Et ceux qui étaient dans le vrai, ce sont ceux-là mêmes qui leur ont imposé leur religion ? »
C’était il y a plus de trois ans, dans une rue peu fréquentée du centre-ville de Maputo, capitale du Mozambique. Deux hommes venaient de m’interpeller pour chercher à me faire venir, le dimanche suivant, à leur groupe de discussion chez les Témoins de Jéhovah. Mais notre échange n’a pas vraiment tourné comme ils l’espéraient. Il se trouve que la croyance dans une religion qui a été imposée dans le cadre d’un processus violent – la colonisation, en l’occurrence – à leurs propres ancêtres (et ce n’était pas il y a si longtemps), m’a toujours interpellé, et j’en ai profité pour leur faire part de ma réflexion à ce sujet, d’une certaine manière. Mes interlocuteurs ont d’abord cherché à contourner mon questionnement, expliquant qu’imposer un culte à des gens était contraire aux principes de la religion chrétienne, qui prône des valeurs de paix et d’amour, et donc qu’ils condamnaient cela. Comme je les relançais sur la question de la pertinence de leur foi, en l’opposant aux croyances préchrétiennes de leurs ancêtres, ils finirent par répondre de façon explicite, en reconnaissant que oui, pour eux, leurs ancêtres étaient dans le faux, et les colons et religieux venus les convertir portaient, eux, la bonne religion.
Sur le moment, je ne pus m’empêcher de penser à une loi de février 2005 adoptée par l’Assemblée nationale française, et portant sur l’héritage de la colonisation. À l’époque, son article 4 alinéa 2 avait fait polémique car il disposait que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit » (cet alinéa a finalement été abrogé en février 2006). Comme nous l’avions nous-mêmes évoqué dans un article de juin 2014 (Les trous de mémoire de la droite française), le principe même d’évoquer des « aspects positifs » à la colonisation est discutable, puisque celle-ci est un processus caractérisé (entre autres) par l’occupation et l’exploitation d’un territoire et la mise sous tutelle d’une société. En tant que telle, l’ensemble des actions menées en son nom et dans son cadre – y compris la construction d’infrastructures, d’hôpitaux, d’écoles, etc. – vise à faciliter l’exploitation de la population et du territoire colonisés au profit de la métropole et de ses colons. Or, il me semblait que tout dans la colonisation européenne avait été soumis à des critiques, y compris ce que les nostalgiques de la colonisation appellent les « points positifs » (la construction d’écoles, d’hôpitaux, de routes, etc.).
Tout avait été critiqué, oui, sauf la religion chrétienne. Non que le principe qu’elle ait été imposée soit cautionné, mais la foi dans le christianisme, elle, n’est pas remise en question en tant que telle. Le christianisme serait-il le seul « point positif », incontestable, de la colonisation ? Vu du regard des Africains pratiquant cette religion, on aurait pu le croire. Alors qu’aux États-Unis, des militants pour l’émancipation des Noirs ont exprimé dans les années 1960 leur rejet du christianisme (considéré comme la religion des exploiteurs blancs) au point d’en sortir – l’exemple le plus connu étant celui de Malcom X –, en Afrique, il ne semble pas qu’un phénomène similaire ait été observé. D’où un sentiment de gêne devant la foi par des Africains en une religion qui a été imposée à leurs ancêtres (par les miens) il y a moins d’un ou deux siècles, alors qu’en Europe même le culte chrétien est plutôt sur le déclin… Quelques éléments de réflexion.

Pour rappel, le christianisme est apparu en Afrique il y a plusieurs siècles, dès le début de l’ère chrétienne. Parmi les premiers Pères qui ont porté cette religion, on compte des Berbères, des Égyptiens et des Éthiopiens. Dans la première version de l’organisation de l’Église, la Pentarchie (soit cinq « têtes »), celle d’Alexandrie, qui avait autorité jusqu’en Éthiopie, arrivait en troisième place. Par ailleurs, les Byzantins puis les Vandales ont diffusé la religion dans le Maghreb. C’est l’expansion musulmane qui, à partir du VIIème siècle, va interrompre celle du christianisme.
Il faut attendre les Grandes Découvertes européennes pour voir en Afrique de nouvelles missions catholiques, exclusivement portugaises jusqu’à l’abolition de la traite négrière, mais elles demeurent peu nombreuses. À la fin du XIXème siècle, les chrétiens compteraient en leur sein à peine 1% d’Africains.
Au XXème siècle, une nouvelle période d’expansion s’amorce, surtout en Afrique subsaharienne (où l’islam reste peu implanté), à travers le prosélytisme évangélique et l’apparition de nouvelles Églises. Le catholicisme croît lui-aussi, notamment dans les colonies portugaises, belges et françaises. Au début du XXIème, l’Afrique est le continent où le nombre de chrétiens augmente le plus vite, en dépit du fait qu’elle ait été originellement imposée par les missions ayant accompagné la colonisation européenne. En 2010, plus ou moins 23% des chrétiens dans le monde se trouvaient en Afrique, et le christianisme était la religion la plus pratiquée en Afrique subsaharienne (63%), devant l’islam (30%) et les cultes traditionnels.
L’Église éthiopienne est l’une des plus anciennes au monde, constituée au IVème siècle, et devenue indépendante de l’Église égyptienne en 1959. Elle compte 30 millions de croyants orthodoxes, qui représentent 43,5% de la population éthiopienne ; en Érythrée, ils sont 20%. La part des catholiquesparmi les chrétiens africains est d’environ 21%, et cette proportion tend à croître. Les autres, protestants et évangéliques, représentent 36% de la population subsaharienne. L’Afrique compte 165 millions d’évangéliques, et là encore, ils sont en expansion. Les Églises fondées par les Africains eux-mêmes (dites d’institution africaine) comptent des centaines de milliers de fidèles. Les plus importantes sont le Kimbanguisme dans la République démocratique du Congo, l’Église harriste en Côte d’Ivoire, et le mouvement Aladura au Nigéria ; elles ont vu le jour entre les deux guerres mondiales et ont joué un rôle dans la décolonisation. Au-delà de cette catégorisation, une étude estimait en 1968 à près de 6.000 les Églises indépendantes en Afrique ; elles étaient 11.500 en 2004, pour la plupart inconnues en Europe.

La religion chrétienne dans la colonisation : quel rôle dans le processus d’acculturation ?
À ce stade, il est important de rappeler des éléments d’Histoire sur le lien entre religion et colonisation. Celui-ci a parfois été complexe, et les interconnexions entre État et Église peu évidentes. Les historiens ne s’entendent pas tous sur le sujet. Mais de fait, les missions se sont multipliées avec l’accélération de la colonisation au cours des XIXème et XXème siècles ; leurs relations avec l’État colonial ont été faites de collaboration, de consensus, mais aussi de conflits – surtout après l’époque coloniale proprement ibérique, puisque jusque-là l’Église participait activement à la colonisation et la religion servait même de « cadre conceptuel » aux colonisateurs. Globalement, on peut quand même dire que l’État colonial, jusqu’au bout, est apparu comme le protecteur naturel des missions chrétiennes.
En France, malgré la dimension laïque de la IIIème République, l’approche française qui prônait l’assimilation des populations colonisées (au contraire de la colonisation britannique) se prêtait très bien à faire des missionnaires des agents de transmission de l’esprit colonial. Le pouvoir politique chercha à instrumentaliser les missions, avec plus ou moins de succès. Celles-ci prirent des distances avec l’État après la Première Guerre mondiale, au profit de la défense des droits des populations opprimées. Côté britannique, le protestantisme s’est étendu à la faveur des explorations d’aventuriers, de commerçants, de philanthropes, sans projet colonial porté par une vision universelle. Quant aux colonies portugaises, elles étaient considérées par la métropole comme un prolongement naturel du territoire européen – à ce titre, elles passent d’ailleurs du statut de colonies à celui de provinces d’outre-mer en 1951 –, c’est pourquoi la religion catholique était largement favorisée, et ceux qui l’adoptaient parmi les autochtones accédaient au statut d’assimilés, qui ouvrait la porte à des avantages.
La religion a assumé un rôle considérable dans le processus d’acculturation des sociétés africaines, à l’époque coloniale comme après les indépendances. Le fait religieux a été un outil idéologique essentiel. La « mission civilisatrice » des Européens en Afrique devait invariablement comporter une dimension religieuse forte. En effet, depuis l’Occident, le regard sur les peuples colonisés était en partie déterminé par les croyances des uns et des autres, puisqu’on assimilait à chaque race un culte. La hiérarchie des races s’accompagnait donc, implicitement, d’une hiérarchie des religions : le christianisme en haut, les religions orientales et l’islam ensuite, les cultes animistes en bas. Le progrès du christianisme était donc assimilé à celui de la civilisation – et ce d’autant plus que les missions prenaient souvent en charge l’apprentissage de la lecture et de l’écriture aux indigènes.
Un phénomène d’appropriation s’est progressivement effectué. Un peu à la manière de ce que les Africains déportés en esclavage sur le continent américain (et leurs descendants) ont pu faire, on observe en Afrique de nombreux phénomènes de syncrétisme. Les colonisés ne furent pas que des victimes apathiques qui reçurent de façon « passive » le message d’une religion transmis par des colonisateurs « actifs ». Les colonisés assimilèrent, réinterprétèrent, transformèrent la religion transmise, avec créativité, en fonction de leurs propres racines religieuses. En outre, le fait religieux entrait dans des stratégies de mobilité sociale, puisque devenir chrétien permettait de mieux s’« assimiler » et donc de s’intégrer dans la société coloniale. Le christianisme était considéré – et cette vision perdure aujourd’hui – comme un facteur de modernité, face à des cultes locaux dits traditionnels, dans une forme d’opposition binaire qui reproduit la hiérarchisation des croyances évoquée plus haut. Il persiste une forme de mépris vis-à-vis de ces rites, qui éloigneraient les individus de la civilisation pour les rapprocher de leur état de nature… Mépris qui va souvent de paire avec une morgue pour les dialectes, les coutumes et les habits « traditionnels ». Dans son premier roman L’hibiscus pourpre (2004), l’auteure nigériane Ngozi Adichie disait de l’un de ses personnages, Eugene, un riche notable, catholique fondamentaliste et père de la narratrice, qu’il « appréciait que les villageois fissent un effort pour parler en anglais en sa présence. Il disait que cela montrait qu’ils avaient du bon sens. […] » Ce même Eugene est adorateur de l’Évangile, et méprise les croyances précoloniales – des cultes païens détestables, évidemment !
Un héritage profondément européen… mais jamais contesté
Bien entendu, le christianisme a une vocation universelle, et c’est d’ailleurs bien ce qui explique que tant d’Africains, certes parfois avec une dose de syncrétisme, parviennent à y adhérer. Toutefois, il suffit de se plonger dans les textes chrétiens pour y percevoir leur dimension euro-méditerranéenne. L’ensemble des références géographiques mentionnées y concernent l’Europe méditerranéenne et le Moyen-Orient, et à aucun moment on y découvre l’existence de peuples d’Afrique subsaharienne (en dehors de ceux de la vallée du Nil peut-être), d’Amérique précolombienne, d’Océanie ou d’Asie extrême-orientale. Le christianisme est une religion qui à ses origines s’est profondément européanisé, le choix de Rome et de Constantinople comme capitales initiales ayant évidemment conforté cela ; cette réalité s’est renforcée avec les conquêtes arabes et le recul de l’autorité chrétienne sur les terres du Levant et d’Afrique du Nord. Les rites catholiques, orthodoxes et protestants sont pour la plupart très fortement marqués par l’empreinte des sociétés qui les ont construits.
Toute religion naît dans un contexte historique, géographique et social particulier, et en porte la marque. Le christianisme est héritier d’un système de valeurs, d’une certaine connaissance du monde, ce qui impose de relativiser l’argument de l’« universalisme » chrétien. Ce qui explique que tant de peuples extra-européens aient « adopté » ce culte, c’est qu’ils l’ont adapté à leurs propres croyances, saints, traditions et rites. La remise en cause de cette religion est inexistante, également parce que les niveaux d’éducation sont faibles dans de nombreux pays, ce qui peut faciliter l’embrigadement des masses dans certaines sociétés. En outre, de nombreuses Églises nouvelles sont avant tout le fruit de charlatans. L’information récente selon laquelle le continent africain domine le classement des 20 pasteurs les plus riches du monde, illustre l’absurdité de la permanence d’une religion qui est supposée promouvoir l’humilité et la sobriété, non l’accumulation de richesses ; parmi ces 20 pasteurs les plus riches au monde, 7 sont nigérians et sont devenus des célébrités nationales.
La persistance, sur le sol africain, d’une religion où domine l’Homme blanc, et où la Vierge et le Christ sont le plus souvent représentés sur la base de standards de beauté européens (blonds aux yeux bleus), a de quoi interroger. Elle diffuse de manière plus ou moins implicite le même message de hiérarchie raciale (jusque depuis le point de vue de Dieu) qu’à l’époque de la colonisation. Ce succès « culturel » des Européens en Afrique leur permet de conférer aux anciens colonisateurs une mission prophétique, qui participe à relativiser la violence du processus de domination et d’exploitation qui les a conduits sur le continent africain. Comme si finalement, la colonisation avait été un moindre mal pour amener la « bonne parole ». Quant à l’argumentaire selon lequel l’Église a participé, en dépit des barrières et des préjugés, à donner aux Africains les structures sociales favorables à leur émancipation, il fait semblant d’oublier 1) qu’elle a d’abord participé au processus historique qui a débouché sur leur état de soumission (dans le cadre colonial) ; 2) que les peuples africains n’ont pas attendu d’être convertis au christianisme pour résister ou se révolter face aux occupants ; et 3) que cette aide « chrétienne » induit un niveau d’acculturation particulièrement violent, lié à l’adhésion des convertis aux standards de vie et aux valeurs importés par les Européens. L’éducation religieuse s’est faite au prix de la maîtrise du savoir, des traditions, des valeurs, des uses et des coutumes précoloniaux.
L’apport de cette religion sur le sol africain s’est fait, comme l’ensemble des conséquences culturelles et identitaires liées à la colonisation, au prix de l’érosion des richesses et des valeurs intellectuelles, religieuses et politiques préexistentes. Certaines critiques ont certes émergé sur le rôle des missionnaires, l’un des exemples les plus connus étant celui de Jomo Kenyatta, premier président du Kenya, qui avait déclaré en son temps : « Lorsque les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous avons rouvert les yeux, nous avions la Bible et eux la terre. » Mais elles concernent toujours la participation des missionnaires à la colonisation, et non le principe même de la foi en une religion étrangère et imposée.
Cette phrase prononcée par un jeune universitaire dans Le malentendu colonial (2005), un film du réalisateur camerounais Jean-Marie Teno qui traite des problèmes de l’Afrique moderne, peut servir de conclusion à cette modeste réflexion : « On peut pardonner aux Occidentaux d’avoir un temps enlevé les terres, mais pas d’avoir enlevé le mental. »
Le texte qui suit, écrit en 1961, est extrait de la préface que Jean-paul Sartre a rédigé pour l’ouvrage Les Damnés de la Terre, écrit et publié la même année par le psychanalyste et activiste anticolonial Frantz Fanon. L’essai de Fanon se penche sur le colonialisme, l’aliénation du colonisé et les guerres de libération ; tout en prônant la lutte anticoloniale, il étudie le rôle que joue la violence entre colonisateur et colonisé. Le livre expose aussi, avec un grand sens de l’anticipation, les contradictions inhérentes à l’exercice du pouvoir dans l’ère post-coloniale en Afrique.
C’est en grande partie grâce à la préface rédigée par Jean-Paul Sartre que l’essai devint célèbre, car Sartre va plus loin que Fanon en justifiant la violence, jusque les attentats contre les civils – en pleine guerre d’Algérie, on imagine bien comment cela fut reçut par une partie de l’opinion. Dans l’extrait qui suit, Jean-Paul Sartre analyse la colère que ressentent les populations colonisées et, au fil des lignes, l’auteur et philosophe existentialiste français aborde la question de l’aliénation des « indigènes » à la religion, en remplacement de l’aliénation coloniale. Il condamne les pratiques de dévotions excentriques pratiquées par les colonisés, ainsi que la nouvelle réalité de soumission dans laquelle ils se placent vis-à-vis de la religion, après l’indépendance.
Cette furie contenue, faute d’éclater, tourne en rond et ravage les opprimés eux-mêmes. Pour s’en libérer, ils en viennent à se massacrer entre eux : les tribus se battent les unes contre les autres faute de pouvoir affronter l’ennemi véritable – et vous pouvez compter sur la politique coloniale pour entretenir leurs rivalités ; le frère, levant le couteau contre son frère, croit détruire, une fois pour toutes, l’image détestée de leur avilissement commun. Mais ces victimes expiatoires n’apaisent pas leur soif de sang ; ils ne s’empêcheront de marcher contre les mitrailleuses qu’en se faisant nos complices : cette déshumanisation qu’ils repoussent, ils vont de leur propre chef en accélérer les progrès. Sous les yeux amusés du colon, ils se prémuniront contre eux-mêmes par des barrières surnaturelles, tantôt ranimant de vieux mythes terribles, tantôt se ligotant par des rites méticuleux : ainsi l’obsédé fuit son exigence profonde en s’infligeant des manies qui le requièrent à chaque instant. Ils dansent : ça les occupe ; ça dénoue leurs muscles douloureusement contractés et puis la danse mime en secret, souvent à leur insu, le Non qu’ils ne peuvent dire, les meurtres qu’ils n’osent commettre. En certaines régions ils usent de ce dernier recours : la possession. Ce qui était autrefois le fait religieux dans sa simplicité, une certaine communication du fidèle avec le sacré, ils en font une arme contre le désespoir et l’humiliation : les zars, les loas, les Saints de la Sainterie descendent en eux, gouvernent leur violence et la gaspillent en transes jusqu’à l’épuisement. En même temps ces hauts personnages les protègent : cela veut dire que les colonisés se défendent de l’aliénation coloniale en renchérissant sur l’aliénation religieuse. Avec cet unique résultat, au bout du compte, qu’ils cumulent les deux aliénations et que chacune se renforce par l’autre. Ainsi, dans certaines psychoses, las d’être insultés tous les jours, les hallucinés s’avisent un beau matin d’entendre une voix d’ange qui les complimente ; les quolibets ne cessent pas pour autant : désormais ils alternent avec la félicitation. C’est une défense et c’est la fin de leur aventure : la personne est dissociée, le malade s’achemine vers la démence. Ajoutez, pour quelques malheureux rigoureusement sélectionnés, cette autre possession dont j’ai parlé plus haut : la culture occidentale. À leur place, direz-vous, j’aimerais encore mieux mes zars que l’Acropole. Bon : vous avez compris. Pas tout à fait cependant car vous n’êtes pas à leur place. Pas encore. Sinon vous sauriez qu’ils ne peuvent pas choisir : ils cumulent. Deux mondes, ça fait deux possessions : on danse toute la nuit, à l’aube on se presse dans les églises pour entendre la messe ; de jour en jour la fêlure s’accroît. Notre ennemi trahit ses frères et se fait notre complice ; ses frères en font autant. L’indigénat est une névrose introduite et maintenue par le colon chez les colonisés avec leur consentement.
Par David Brites
Source : lallumeurdereverberes.com
Sun, 12 Apr 2020 16:36:00 +0200
0