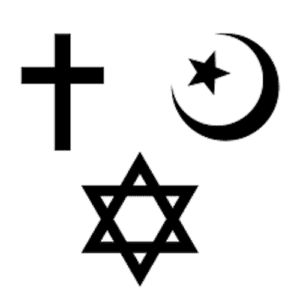Le coup de fil Gbagbo-Chirac qui a tout déclenché Ce que dit un rapport confidentiel de l’ONUCI

Le téléphone «coupé» entre Gbagbo et Chirac
Mécontent de la fermeté qu’affiche son homologue Laurent Gbagbo, le président Chirac élève la voix oubliant vite que son interlocuteur est attentif à la fois à la forme et au contenu de son propos. Soudain, le président Gbagbo, qui l’écoute depuis un moment, l’interrompt et lui dit que sa décision de lancer l’offensive est déjà prise, qu’il souhaitait simplement l’en informer. Il raccroche le combiné. Le président Gbagbo explique : « Après cet échange avec Jacques Chirac, nous avons décidé de conduire l’attaque contre les rebelles avant la date effective afin que la France ne puisse pas réagir contre notre initiative militaire ». Pourtant, quelques jours avant l’offensive de l’armée ivoirienne, les officiers français étaient déjà au courant, du fait des indiscrétions des officiers ivoiriens, des préparatifs de l’attaque contre les rebelles (….) Dans la matinée du 4 novembre 2004, l’offensive est donc lancée contre les rebelles. Elle porte exclusivement sur des objectifs militaires des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN) situés dans la région de Bouaké. Le lendemain, l’offensive ivoirienne se poursuit dans la zone des rebelles. Les Sukhoï 25 et les MI 24 pilonnent les positions militaires rebelles. Un rapport confidentiel de l’ONUCI daté du 9 novembre 2004 souligne que les bombardements de l’armée ivoirienne ont atteint des cibles militaires. Selon des sources proches de l’ONUCI, « il suffisait d’un jour supplémentaire de bombardements de l’armée ivoirienne et la rébellion du Nord aurait été complètement anéantie ». Cette perspective était inacceptable pour l’Elysée. C’est dans ce contexte de tension et de parti pris politique que survient l’attaque contre le cantonnement français le 6 novembre 2004 à Bouaké. Qui a donné l’ordre de bombarder le camp français de Bouaké et dans quel objectif ? Selon les informations en notre possession, le président Laurent Gbagbo semble n’avoir pas même été informé de ce qui allait réellement se produire ce jour-là (….) Le bombardement du camp français fut un acte délibéré et fortement suggéré aux pilotes mercenaires pour incriminer monsieur Gbagbo. Dans quel intérêt Laurent Gbagbo, qui cherchait des voies d’apaisement avec la France, aurait-il poussé ses soldats à commettre un tel acte contre des militaires français ? Il est évident que même un piètre sous-officier rongé par la mégalomanie n’aurait jamais envisagé de bombarder un campement de soldats français à ce moment-là. Le général Poncet, contrairement à ce qu’il a avancé un temps dans la presse, sait qui a donné l’ordre de tirer sur le lycée Descartes à Bouaké. Revenons sur le déroulement des faits et l’on comprendra davantage l’étrange attitude des autorités françaises. Dès le 2 novembre 2004, lorsque les Sukhoï 25 arrivent à l’aéroport de Yamoussoukro, un détachement de recherche du 2ème régiment de Hussards reçoit l’ordre de les surveiller. Deux équipes, se relayant chaque jour, auront ainsi les yeux rivés sur le tarmac. Elles notent, filment et relèvent tous les détails susceptibles de fournir des indications sur les actions des Sukhoï 25. Les Français réussissent même à photographier les pilotes des Sukhoï 25 ainsi qu’une partie du personnel navigant. Toutes ces données sont envoyées au bureau de renseignement G2 du PCIAT (Poste de Commandement Interarmées de Théâtre) à Abidjan. Les mêmes informations sont également transmises au bureau du chef d’état-major des armées à Paris ainsi qu’à la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) et à la DRM (Direction du Renseignement Militaire). Nul ne peut donc prétendre que l’information n’est pas disponible sur les Sukhoï 25 et sur leur personnel. Lorsque l’attaque est achevée, la première décision qui vient de Paris est la destruction des Sukhoï 25 et pas une demande d’arrestation du commando qui vient de liquider les militaires français et d’en blesser d’autres. D’ailleurs, l’ordre de destruction des Sukhoï ivoiriens a été diversement apprécié au sein de la Force Licorne. Dans la tension et la confusion qui règnent autour de la mort des soldats français à Bouaké, certains officiers se rendent vite compte, à leur grand étonnement, que le pouvoir politique n’est pas très intéressé de voir une enquête s’ouvrir sur cette attaque particulièrement brutale.
Comment Paris a fait obstruction à l’enquête
Le lendemain, 7 novembre, le général Poncet et ses hommes arrêtent neuf ressortissants ukrainiens, quatre ressortissants biélorusses et deux ressortissants russes. Au total, quinze personnes suspectes sont immédiatement placées en rétention dans un hangar par les militaires français. Alors qu’un gendarme du commandement des opérations spéciales tente, avec quelques militaires, de les interroger pour en savoir davantage sur leur responsabilité éventuelle dans le bombardement contre le lycée Descartes, un ordre venant du Quai d’Orsay exige la libération immédiate des mercenaires slaves détenus par les Français. « Pour demander l’extradition de ces ressortissants, il aurait fallu qu’un mandat international soit délivré. Cela n’a pas été le cas. A l’époque, nous n’avions aucun élément de preuve, les photos par exemple n’étaient pas déterminantes. Nous n’avions donc rien à leur reprocher » expliquera le ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie. Ses propos font bondir les experts et certains militaires (…) Prétendre que la France avait besoin d’un mandat d’arrêt international pour procéder à l’arrestation des suspects n’est pas totalement exact car la loi du 14 avril 2003 réprimant l’activité des mercenaires offrait une singulière opportunité d’auditionner ces personnes qui avaient, pour certaines, participé au transport de munitions de l’avion Antonov 12 et pour d’autres, des liens avec les pilotes des Sukhoï 25. En outre, affirmer qu’il n’y avait rien à leur reprocher signifie au moins que les informations accumulées par les militaires et les services de renseignements français étaient sans intérêt, au plus qu’elles n’avaient aucun lien avec le bombardement de Bouaké. Le 11 novembre 2004, à la demande expresse de l’ambassadeur de France, les Français remettent, sans trop renâcler, les quinze mercenaires aux autorités consulaires russes. Après cet épisode particulièrement confus, les autorités françaises s’illustrent à nouveau en laissant, cette fois, les pilotes du Sukhoï 25 s’évader. Que s’est-il passé ? Quelques jours après le bombardement, les auteurs s’éclipsent clandestinement vers le Togo, pays voisin de la Côte d’Ivoire. Au cours d’un contrôle routier à la frontière du Ghana et du Togo, ils sont arrêtés à bord d’un car par les forces de police togolaises (…) Au vu des éléments, le ministre de l’Intérieur togolais, qui remarque la fébrilité des services de renseignement français à l’annonce de ces arrestations, cherche à comprendre pourquoi la France ne s’empresse pas d’exiger l’extradition des suspects biélorusses afin que la justice française fasse la lumière au plus vite sur cette étrange affaire. Ne voyant rien venir, les autorités togolaises se lassent de garder indéfiniment les Biélorusses en prison. Selon certains observateurs, le comportement des autorités françaises dans ce dossier est plus que troublant. Elles vont d’ailleurs multiplier à l’infini les obstacles au travail des juges. Ceci nous a été confirmé par la juge Brigitte Raynaud qui était chargée, dès le début, du dossier (…) La première personne qui ne montre pas une franche détermination à connaître les auteurs et les commanditaires de l’attaque du lycée Descartes est bien la ministre Michèle Alliot-Marie. Pourquoi la ministre Michèle Alliot-Marie, a-t-elle laissé s’évader les auteurs du bombardement de Bouaké alors qu’ils étaient arrêtés par les autorités togolaises et mis à la disposition des autorités françaises ? Pourquoi n’a-t-elle pas facilité le travail de la justice française alors que celle-ci était disposée à tirer cette affaire au clair ? Pourquoi avoir refusé de faire une autopsie des corps des militaires pour aider la justice à démasquer éventuellement le président Gbagbo ? Pourquoi avoir inversé les corps des soldats dans les cercueils au point d’ajouter à la douleur des familles, un traumatisme inutile ? Pourquoi ne veut-on pas connaître qui a ordonné le bombardement de Bouaké ? Pourquoi l’Elysée n’a jamais encouragé la déclassification de tous les documents demandés par les juges s’il n’y a rien à craindre de son côté ? A qui la vérité sur cette affaire pose réellement problème ? Il faut avouer que ce n’est certainement pas au président Laurent Gbagbo. Il nous a confié : « Nous ne savons pas dans quelles circonstances précises les neuf Français ont trouvé la mort. L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Monsieur Le Lidec m’avait téléphoné pour m’annoncer que les Biélorusses avaient été arrêtés à Abidjan par les militaires français. J’étais donc très heureux de savoir qu’ils étaient aux arrêts et surtout que la vérité allait éclater. Nous avons cru que nous allions savoir pourquoi les soldats français avaient été tués et qui avait donné l’ordre de commettre un tel acte. J’ai finalement appris qu’ils avaient été libérés par les Français et nous n’avons jamais reçu le moindre procès-verbal d’audition les concernant ni des éléments d’une enquête préliminaire sur leur arrestation en Côte d’Ivoire. J’ai par la suite appris qu’ils avaient été arrêtés au Togo et que le ministre de l’Intérieur du Togo les avait entendus. Ce dernier aurait essayé en vain de joindre les ministres français de la Défense et de l’Intérieur pour obtenir l’extradition des suspects biélorusses. Jusqu’ici, nous ne savons toujours pas qui a tué les soldats français ni pourquoi ils ont été tués. Ceci signifie qu’on peut formuler des hypothèses sur cette affaire ».
Lu dans Marianne (magazine français) du Jeudi 22 Décembre 2011
Thu, 05 Jan 2012 02:26:00 +0100
0