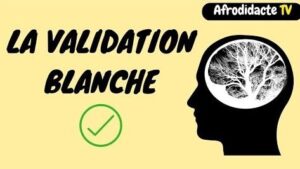Thabo Mbeki/ L’architecture de l’Afrique : de la guerre froide à la mondialisation

Ces pays qu’on appelait alors les « superpuissances » ne pouvaient que se féliciter, au moins en principe, de la liquidation du système colonial et donc de notre nouvelle capacité à exercer notre droit à l’autodétermination, partout en Afrique. Mais dans ce contexte de guerre froide, de nouveaux problèmes sont apparus, car ces superpuissances ont commencé à intervenir sur notre continent pour faire valoir leurs intérêts respectifs et s’assurer que l’Afrique depuis peu indépendante emprunte une voie conforme à leurs objectifs globaux.
Je reste convaincu que de ce point de vue, l’Union soviétique, et donc l’approche socialiste, a bénéficié d’une position stratégique plus solide pour gagner l’allégeance de l’Afrique libérée.
Et ceci essentiellement pour deux raisons :
— dans l’idéologie marxiste-léniniste, le droit à l’autodétermination des peuples occupait une place essentielle dans la perspective d’une marche vers la victoire du modèle socialiste ;
— perçue comme anti-impérialiste, l’Union soviétique voyait un allié dans le mouvement anticolonial, contre son adversaire direct, l’impérialisme et ses puissances associées.
La réalité historique est que beaucoup, et peut-être même la majorité, des forces politiques africaines qui ont lutté pour la libération de la domination coloniale ne pouvaient qu’être attirées par une attitude anti-impérialiste, fût-elle associée à l’Union soviétique, tête de file de la sphère socialiste.
Les dirigeants politiques américains, quelle que soit leur affiliation partisane, partageaient alors une idéologie anticommuniste et antisoviétique commune, et percevaient les implications de la décolonisation en Afrique au travers de ce filtre. Ils partageaient cette approche avec leurs alliés, notamment les principales puissances d’Europe occidentale, capitalistes comme eux, et dont ils avaient obtenu la fidélité grâce à des programmes comme le plan Marshall et diverses interventions visant à soutenir leurs formations politiques antisoviétiques et anticommunistes.
C’est dans ce contexte que les États-Unis et l’Europe occidentale prirent conscience que l’Afrique pouvait emprunter une direction opposée à la leur ce qui, dans leur phraséologie, recouvrait la diffusion de la maladie mortelle de l’« expansionnisme soviétique ». Il devint donc inévitable que les puissances capitalistes occidentales interviennent massivement pour « conserver l’Afrique dans leur sphère d’influence » et donc, autant que possible, empêcher l’Union soviétique d’intégrer notre continent « à sa propre sphère d’influence ».
Les conséquences concrètes de ces actions furent notamment la corruption du projet d’indépendance africaine par l’instauration d’un système néocolonial, le renversement des gouvernements récalcitrants, le soutien aux minorités blanches et aux régimes coloniaux en Afrique australe, car ils étaient perçus comme des alliés fiables dans la lutte contre le communisme et l’Union soviétique, l’assassinat de leaders africains comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Eduardo Mondlane, l’instrumentalisation de mouvements comme l’UNITA en Angola et le RENAMO au Mozambique, le soutien à des régimes prédateurs et clientélistes comme ceux de Mobutu au Zaïre et d’Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire, et même un rôle joué dans des catastrophes majeures comme le fut le génocide rwandais en 1994.
On peut bien sûr faire l’exercice inverse et citer l’influence négative qu’a pu avoir en Afrique le soutien accordé par l’Union soviétique à des régimes perçus comme des représentants progressistes de la « voie non-capitaliste vers le développement ». On peut notamment mentionner le gouvernement de Sekou Touré en Guinée Conakry et le Derg dirigé par Mengistu Haile-Mariam en Éthiopie.
Il faut néanmoins reconnaître que la plupart des évolutions négatives sur notre continent durant cette période de guerre froide proviennent des efforts obstinés de l’Occident pour vaincre ce qui était alors désigné comme l’« expansionnisme soviétique ».
UN PASSÉ ENCORE TRÈS PRÉSENT
Je me suis largement étendu sur la période de la guerre froide, ce qui peut paraître injustifié. Mais il me paraît évident que ce passé fait encore partie de notre présent et qu’il nous est impossible de prendre pleinement la mesure de notre situation actuelle sans une évaluation de ce qui peut paraître, chronologiquement, un passé lointain. En réalité chacun de nos jours, sans exception, est chargé du lourd fardeau que constitue ce passé. Je suis certain qu’en observant l’Afrique « post guerre froide», nous devrons faire une large place aux tendances persistantes issues de cette période.
Il y a 19 ans, le 7 mars 1993, alors que l’Union soviétique venait de disparaître, l’influent New York Times a publié un article de Steven A. Holmes, intitulé « Le monde : Afrique, de la guerre froide à la froideur ». Je me permets de citer largement cet article. Steven Holmes y écrivait entre autres : « Découpés et colonisés par les puissances européennes, puis transformés en pions, cavaliers et tours par les superpuissances sur l’échiquier de la guerre froide, les Africains doivent faire face à un nouveau problème dévastateur : l’indifférence. » Dans le dernier numéro de Foreign Affairs, Marguerite Michaels, chercheuse au Council on Foreign Relations, note que la désintégration de l’Union soviétique « a laissé le champ libre à l’Amérique pour faire valoir ses intérêts en Afrique — mais Washington se rendit vite compte qu’elle n’avait justement pas d’intérêts à défendre sur le continent noir ». Cette analyse est dure. Mais la fin de la guerre froide a réduit l’importance stratégique que l’Afrique pouvait représenter pour l’Occident. Alors que la diminution du revenu par habitant réduit les débouchés pour les entreprises occidentales et que la stagnation du niveau de formation n’incite pas à investir (…) l’attrait économique de l’Afrique tend à disparaître (…) « Je ne suis pas nostalgique de la guerre froide », a dit Salim A. Salim, ancien Secrétaire général de l’OUA, lors d’un discours prononcé récemment à Washington. « Je me félicite de la fin de la guerre froide. Ce qui me préoccupe, c’est la perte d’intérêt pour les problèmes véritablement humanitaires. » (…) L’évolution sans doute la plus significative est la nouvelle volonté des Africains de reconnaître leurs propres erreurs passées — d’arrêter de faire porter la responsabilité du sous-développement du continent entièrement sur l’Occident et sur le legs de la colonisation, pour au contraire condamner les grossiers abus de dirigeants locaux incompétents et corrompus (…) Par le passé, le principe de non- intervention dans les affaires intérieures des autres États africains, gravé dans le marbre de la charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, a permis aux dirigeants du continent de justifier leur inaction même face à des abus flagrants de leurs homologues, comme ce fut le cas avec Idi Amin Dada en Ouganda. « Nous avons laissé commettre des violations des droits de l’homme », a affirmé M. Salim.
« Nous avons fermé les yeux sur la déshumanisation de notre peuple et utilisé la charte comme bouc émissaire de notre impuissance ».
Ces phrases ont été lues par de nombreux décideurs aux États-Unis, qui demeuraient alors la seule superpuissance du nouvel ordre mondial unipolaire de l’après-guerre froide. Elles soulignaient notamment :
— que la fin de la guerre froide laissait l’Afrique dans le flou face aux perspectives géostratégiques mondiales et aux positions de la seule puissance mondiale et de ses alliés occidentaux ;
— que, libérée de l’obligation de courtiser les pays africains indépendants dans le cadre de la lutte contre l’Union soviétique, la puissance américaine découvrait que notre continent ne jouait aucun rôle important dans la préservation de ses intérêts globaux ;
— qu’en conséquence, la « communauté mondiale » pouvait laisser l’Afrique seule face à son destin, à l’exception des « crises humanitaires », la réduisant ainsi à l’échelle globale au seul rôle de récipiendaire de la charité internationale ;
— que l’Afrique comprenait cette réalité, et plaidait que « l’indifférence et la négligence » signifiaient que notre continent, livré à lui-même, ne pouvait pas faire face seul à ses défis humains les plus simples ;
— que l’Afrique devait faire ses preuves en se conformant aux prescriptions du « consensus de Washington », qui prônait démocratie et économie libre et de marché, pour retrouver un rôle de partenaire dans le système capitaliste mondial ;
— que l’Afrique devait seule prendre en charge la résolution des problèmes dont elle avait hérités du fait des politiques menées durant la guerre froide ;
— qu’entre autres choses, dans ce contexte, elle devait se débrouiller seule pour jouer un rôle dans le processus de mondialisation de l’économie ;
— que l’Afrique devait accepter la fin des traitements de faveur accordés par les anciennes puissances coloniales et impérialistes, avec pour corollaire que toute allusion à l’impact durable de la colonisation et de l’impérialisme ne pouvait désormais être qu’une volonté, de la part des Africains, de se dédouaner de leurs propres échecs ;
— qu’ainsi, l’Occident n’avait plus à supporter la responsabilité de venir au secours de l’Afrique pour ce que le secrétaire général de l’OUA appelait alors les « problèmes humanitaires aigus ».
L’Afrique ne peut et ne doit pas se laisser aller à une situation autarcique, déconnectée du reste du monde, y compris de l’Occident. Nous devons donc examiner les conclusions tirées de l’article du New York Times pour vérifier si elles restent pertinentes dans le cadre de notre discussion sur « l’Afrique de l’après-guerre froide ».
La suggestion essentielle de cet article du New York Times, qui voudrait que, à la fin de la guerre froide, l’Afrique ait été déconnectée de l’économie mondiale capitaliste, est erronée. Pour être exact, l’auteur aurait plutôt dû écrire que la disparition de l’Union soviétique et l’effondrement subséquent du système socialiste a fait perdre à l’Afrique la possibilité qui lui était jusqu’alors offerte de marchander son soutien, dans un contexte qui lui permettait, dans un certain sens, d’exercer son droit à l’autodétermination, même dans un espace réduit. L’émergence d’un monde unipolaire dominé par une unique superpuissance mondiale, les États-Unis, signifiait la disparition de toute force opposée à la domination impérialiste.
L’APPEL À UNE « RECOLONISATION » DE L’AFRIQUE
À d’autres occasions, j’ai tenté d’attirer l’attention sur une école de pensée qui s’exprime essentiellement au Royaume-Uni, et qui appelle, au fond, à une recolonisation de l’Afrique. Cette idée, qu’elle soit exprimée explicitement ou non, est fondée sur l’impératif de garantir le fonctionnement bien huilé des rouages de la mondialisation dans l’après-guerre froide : chaque nation, au sein de la communauté internationale, doit jouer le rôle qui lui est assigné, notamment pour éviter toute rupture et tout dysfonctionnement au sein du système économique mondial.
Dans cette perspective, nous, Africains, avons pu entendre le reproche qui nous est fait de ne pas avoir montré notre capacité à gérer nos propres affaires et tenir ainsi notre rôle au sein du système intégré et universel de la mondialisation, pour en garantir l’intégrité et le bon fonctionnement. On comprend que, dans l’intérêt du bien commun, ce sont les autres composantes de ce système international qui doivent intervenir pour s’assurer que nos lacunes soient corrigées voire évitées. Et ceci pour le bien de toute l’humanité et même le nôtre !
J’ai déjà pointé les déclarations de plusieurs commentateurs britanniques en ce sens, par le passé.
Parmi elles, on peut noter un article du 2 juin 2003, signé par Bruce Anderson, éditorialiste de The Independent à Londres. On pouvait y lire « l’Afrique est un superbe continent, et ses habitants si attachants et si volontaires méritent mieux que la manière dont ils sont aujourd’hui contraints de vivre et de mourir. Il n’est cependant pas certain que l’Afrique porte en elle la capacité de générer son propre salut. Il est sans doute nécessaire d’imaginer une sorte de néo- impérialisme, où la Grande Bretagne, les États-Unis et d’autres nations choisiraient les leaders africains et les guideraient sur la voie du libre marché, de l’État de droit et, au bout du compte, d’une variante africaine viable de la démocratie, tout en se réservant la possibilité de les écarter du pouvoir en cas de dérapage ».
Le 14 janvier 2001, un autre éditorialiste britannique, Richard Gott, écrivait dans le magazine New Statesman: « Il semble qu’une nouvelle tendance se fait jour, en faveur d’une reconquête de l’Afrique, et les missionnaires du New Labour y prennent leur part (…) L’opinion publique reste souvent perplexe et désarmée lorsque les gouvernements s’embarquent dans des interventions néocoloniales (en Afrique). Les nouveaux missionnaires (intellectuels et organisations non gouvernementales qui « submergent les ondes et polluent la couverture de l’actualité africaine avec leur récit partial faisant la part belle à la tragédie et au désastre ») ressemblent à s’y méprendre aux missionnaires d’antan: c’est une avant-garde qui pave la voie à une conquête militaire et économique ».
Le diplomate et théoricien anglais Robert Cooper était alors conseiller du premier ministre Tony Blair. Il travaille désormais auprès du chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. Dans un essai publié en 2000, intitulé L’État postmoderne et l’ordre mondial, il a conforté les points de vue cités ci-dessus, avec des arguments en apparence sophistiqués. Sur le fond, il affirmait que ces États postmodernes, principalement les pays occidentaux de premier plan, étaient les dénominateurs de toute l’humanité, du fait du rôle intégrateur du processus de mondialisation.
Il écrivait entre autres dans cet essai : « Quelle attitude devons-nous tenir face au chaos pré-moderne qui se manifeste dans diverses régions du monde ? (…) Quelle forme doit prendre notre intervention ? La méthode la plus logique face à un tel chaos, et qui a été le plus souvent utilisée par le passé, est la colonisation. Mais la colonisation est inacceptable pour les États postmodernes (pour certains États modernes également). Or, c’est précisément à cause de la mort de l’impérialisme que réapparaît le monde pré-moderne (…) Toutes les conditions de l’impérialisme sont là, mais l’offre comme la demande d’impérialisme se sont asséchées. Et néanmoins, le faible a toujours besoin du fort, et le fort a toujours besoin d’un monde stable. Un monde où les nations les plus avancées et les mieux gouvernées exportent la stabilité et la liberté et un monde ouvert à l’investissement et à la croissance — toutes choses éminemment désirables. Nous avons donc besoin d’une nouvelle forme d’impérialisme, qui soit acceptable dans un monde gouverné par les droits de l’homme et les valeurs cosmopolites. Nous pouvons déjà en discerner les contours : comme tous les impérialismes, celui-ci viserait à apporter ordre et organisation, mais il reposerait sur le principe du volontariat. L’impérialisme postmoderne peut prendre deux formes. La première est l’impérialisme volontaire de l’économie globale. Il est généralement mis en œuvre par un consortium international, au travers des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale — c’est une des caractéristiques du nouvel impérialisme que d’être multilatéral (…) Si les États souhaitent en bénéficier, ils doivent s’ouvrir à l’ingérence d’organisations internationales et d’États étrangers (de la même manière que, pour différentes raisons, le monde postmoderne s’est lui aussi ouvert) ».
INTERVENTIONNISME ET « EXCEPTIONNALISME » OCCIDENTAUX
Nous avons vu ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire et en Libye au cours de l’année écoulée, après avoir autorisé des pays non-africains, mandatés par le Conseil de sécurité de l’ONU, et sans considération pour l’opinion africaine, à renverser par la force des gouvernements en place et ainsi favoriser des changements de régime correspondant à l’intérêt des puissances occidentales. Il y a à peine deux décennies, une majorité d’Africains auraient qualifié ces pays de puissances impérialistes, selon la définition première du terme. Mais en intervenant en Côte d’Ivoire et en Libye, ces nations ont cherché à justifier leurs actions par la défense des intérêts africains : leur engagement si désintéressé était encore plus décidé à protéger ces intérêts que nous ne l’étions, nous, Africains !
Sans doute pour atteindre ce noble objectif, ils sont même parvenus à donner corps à leur propre fiction selon laquelle la Libye n’est pas un pays africain mais uniquement un pays arabe, dont la destinée doit être décidée par les déclarations de la Ligue arabe, et non par celles de l’Union africaine !
Il faut souligner aussi que ces puissances ont mené leurs interventions sur notre continent en plaidant qu’elles agissaient par bonté d’âme, dans le but de nous apporter à nous, Africains, les présents de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix et sauvegarder les vies de millions d’Africains qui auraient sans elles été massacrés par les gouvernements en question. Et c’est ainsi que s’est produit le miracle : ceux que nous connaissions ou avions connus comme nos maîtres coloniaux, néocoloniaux ou impérialistes sont réapparus sur notre continent, se présentant comme les meilleurs des vrais amis des peuples africains !
Henry Kissinger a donné la clé pour comprendre ce processus dans Diplomacy, publié en 1994. Il écrivait qu’en arrivant au pouvoir, Reagan « voulait atteindre son objectif [de vaincre l’Union soviétique] grâce à une confrontation incessante (…) Reagan fut le premier président de l’après-guerre à passer à l’offensive (contre l’Union soviétique) à la fois sur le plan idéologique et sur le plan géostratégique (…) [Il souhaitait] stopper net la quête soviétique d’une supériorité stratégique et la transformer en un retard stratégique irrémédiable. Le support idéologique utilisé pour obtenir ce renversement fut la question des droits de l’homme, que Reagan et ses conseillers invoquèrent pour tenter de saper le système soviétique. Ses prédécesseurs avaient eux aussi souligné l’importance des droits de l’homme (…) Mais Reagan et ses conseillers allèrent plus loin en faisant de cette question l’outil qui permettrait de renverser le communisme et de démocratiser l’Union soviétique (…) En fait, Reagan a poussé le wilsonisme au bout de sa logique. L’Amérique ne pouvait pas attendre passivement que les institutions évoluent, et ne pouvait pas non plus se contenter de répondre aux menaces directes à sa sécurité. Au contraire, elle doit activement promouvoir la démocratie, récompenser les pays qui donnent corps à ses idéaux et punir ceux qui s’y opposent — même s’ils ne constituent pas une menace visible pour l’Amérique (…) La doctrine Reagan revenait à une stratégie de soutien aux ennemis des ennemis de l’Amérique (…) L’administration Reagan apporta son appui non seulement à d’authentiques démocrates (comme en Pologne) mais aussi à des fondamentalistes islamistes (de connivence avec l’Iran) en Afghanistan, à des extrémistes de droite en Amérique centrale et à des seigneurs de la guerre en Afrique (…) Ils partageaient un ennemi commun, et dans un monde où les intérêts nationaux priment, cela faisait d’eux des alliés (…) L’équipe Reagan retourna ainsi la revendication des jeunes bolchéviques: l’horizon était constitué par les valeurs démocratiques, et non plus par celles du Manifeste du Parti communiste. »•1
Depuis de nombreuses années, la politique étrangère américaine est fondée sur les deux propositions conjointes d’une « exception » américaine et du « destin manifeste » que l’Amérique devait dessiner le contenu de l’ordre mondial. On retrouve cette tendance dans un entretien de la secrétaire d’État Hillary Clinton, publié par le magazine Time le 27 octobre 2011. Elle affirmait entre autres : « Lorsque j’ai pris mes fonctions de secrétaire d’État, j’ai trouvé chez nos amis et alliés du monde entier beaucoup de doutes, d’inquiétudes et de peurs. J’ai donc essayé de réaffirmer le leadership américain, tout en reconnaissant que le XXIe siècle nous impose un mode de direction différent de ce que nous avons pu connaître (…) Si certains s’éloignent de vous, si d’autres choisissent une voie différente, il faut vous efforcer de les convaincre que la voie que vous envisagez est aussi celle qui protège leurs intérêts. Nous avons consacré beaucoup de ressources à ce type de discussions au cours des deux dernières années (…) Et cela peut paraître quelque peu inhabituel, de prime abord, que mon but soit de réaffirmer notre leadership en nous appuyant sur les valeurs (…) en utilisant (…) ce qu’on appelle le smart power pour bâtir des coalitions et des réseaux plus solides (…) dans lesquels nous prenons toute notre part (…) Nous devons rechercher les voies permettant à l’Amérique d’étendre sa présence économique, son influence, tout en travaillant avec la Chine. Cela fait partie de mes objectifs que d’intégrer les États-Unis à l’architecture régionale préexistante en Asie. Il en a été ainsi lorsque la Chine a commencé à faire valoir sa puissance, sans doute les dirigeants chinois estimaient-ils, vu notre situation économique, que nous ne pouvions plus nous permettre d’être aussi impliqués que nous ne l’avions été (…) Notre potentiel géostratégique est limité par la montée en puissance d’autres pays. C’est un fait historique incontournable, qui s’est déjà produit à plusieurs reprises dans l’histoire mondiale. Mais nous ne le percevons pas comme une limite à notre pouvoir. Je le vois plutôt comme un défi qui nous est posé : comment pouvons-nous exercer notre influence au mieux pour renforcer la sécurité, les intérêts et les valeurs de l’Amérique ? (…) Et je suis si imprégnée de ce sens de l’exception américaine et de la conviction que nous sommes appelés à exercer le leadership que j’estime que c’est à nous de définir notre position, pour être le plus efficace possible face aux différentes menaces et opportunités qui surviendront dans le temps. »
En reprenant les écrits de Kissinger, on s’aperçoit que la position des États-Unis en politique étrangère n’a pas changé depuis l’administration Reagan. L’Amérique fait encore valoir sa destinée manifeste à diriger le monde. Elle reste convaincue de cette exception qui justifierait l’affirmation d’Hillary Clinton : « si certains choisissent une voie différente, il faut vous efforcer de les convaincre que la voie que vous envisagez est aussi celle qui protège leurs intérêts ». L’Amérique utilisera tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs géostratégiques. Parmi ces moyens, comme l’explique Kissinger, on trouve l’instrumentalisation de la démocratie et des droits de l’homme.
COMPRENDRE ET RÉPONDRE À L’APPROCHE OCCIDENTALE
Je crois que ce que j’ai affirmé jusqu’ici à propos de la politique étrangère américaine, et qui pourrait être étendu, mutatis mutandis, à la plupart de ses alliés occidentaux, nous impose le devoir d’en saisir les origines objectives, les impératifs, ainsi que les obligations qui en découlent pour nous et l’attitude que nous devons adopter en regard, en évitant de nous contenter puérilement de simples déclarations militantes.
Tout le monde se souvient de la publication, en 2007, par le Council on Foreign Relations d’un ouvrage sur l’Afrique intitulé More Than Humanitarianism: A Strategic Approach Toward Africa (Plus que de l’humanitarisme : une approche stratégique de l’Afrique), qui suggérait que l’Amérique devait considérer l’Afrique comme une région d’importance et d’intérêt géostratégiques, contrairement à ce qu’avançait l’article de 1993 du New York Times cité plus haut.
La publication du Council on Foreign Relations de 2007 soulignait notamment que :
— l’Amérique connaît une dépendance croissante à l’égard de l’Afrique, pour l’importation de pétrole brut ;
— «les États-Unis ne pourront pas compter sur une poursuite de l’approvisionnement en pétrole africain sans une attention portée à la qualité de la gouvernance (…) et à la stabilité à long terme » ;
— la compétition pour l’accès au pétrole et aux autres ressources naturelles africaines, y compris avec la Chine, est croissante ;
— la Chine devient un « concurrent de premier plan à la fois en terme d’influence et de contrats sur le continent » ;
— «l’importance de l’Afrique s’accroît aussi dans les négociations internationales sur le commerce», notamment dans le cadre de l’OMC ;
— « le rôle de l’Afrique se renforce également dans la guerre contre le terrorisme. »
Dans ce contexte, rappelons l’importance de la question soulevée par le diplomate britannique Robert Cooper, sur le devoir du « monde postmoderne », c’est-à-dire les puissances occidentales, d’assurer l’intégrité du processus actuel de mondialisation.
Il paraît clair que l’Afrique doit s’attendre à un certain nombre d’évolutions la concernant, dans ce monde de l’après-guerre froide :
— ce que l’on désigne sous le terme de « monde postmoderne » interviendra sur notre continent où et quand il le jugera nécessaire, pour assurer l’intégrité du processus de mondialisation, et dans la mesure où ce processus sert les intérêts de ce même « monde postmoderne » ;
— ces interventions se concentreront sur les problèmes liés à la « bonne gouvernance », couvrant ainsi les questions de démocratie et des droits de l’homme, notamment parce que le « monde postmoderne » veut préserver une stabilité qui garantira que les déséquilibres africains ne perturberont pas le fonctionnement de l’économie globale, ne nourriront pas le terrorisme international, n’alimenteront pas l’immigration illégale dans ces mêmes pays du « monde postmoderne », etc…
— chaque pays de ce « monde postmoderne » n’interviendra sur notre continent que pour protéger et faire valoir ses propres intérêts.
Tout ceci est basé sur l’idée qu’encore et toujours, du fait de sa faiblesse et depuis les temps de l’esclavage, l’Afrique est là « pour être prise ».
La fin de la guerre froide impliquait que le « monde postmoderne » de Robert Cooper ne trouvait aucune force pour contester sa capacité à imposer ses règles aux autres nations. Mais comme le dit Hillary Clinton en allusion à la Chine, à l’Inde et au Brésil, d’autres puissances émergent. Cette émergence réduit la possibilité pour le « monde postmoderne » d’établir l’hégémonie qu’il recherche.
Cependant, je ne pense pas que cette évolution remette en cause les conclusions que j’ai émises sur les conséquences pour l’Afrique. Fondamentalement, je suis convaincu que la fin de la guerre froide a donné naissance à un nouveau danger pour les peuples africains : la remise en cause de leur capacité à peser sur leur destin, et les appels à un « nouvel impérialisme », comme le montrent les déclarations que j’ai citées. La Côte d’Ivoire et la Libye nous ont déjà montré ce qui peut nous arriver. On peut également citer d’autres développements négatifs, comme la trahison des engagements pris par le « monde postmoderne » lors du Plan d’Action pour l’Afrique du G8 en 2002 et dans le cadre du Round de Doha de l’OMC, ou encore la pression insistante de l’Union européenne pour mettre en place les si inégaux « Accords de partenariat économique ». Toutes ces évolutions soulignent la volonté d’orienter les relations entre l’Afrique et le « monde postmoderne » en fonction des intérêts de ce dernier.
J’aimerais croire que chacun d’entre nous est opposé à tout « nouvel impérialisme », quelle que soit la forme qu’il puisse prendre, et voit donc la défense et l’indépendance de nos peuples comme un impératif fondamental et stratégique. La protection de cette indépendance signifie bien entendu que nous ne devrions pas déléguer à d’autres cette fonction stratégique, et que nous devons la prendre en charge sans équivoque, que nous devons enraciner la démocratie dans nos pays, protéger les droits de l’homme, et nous assurer que nos pays sont convenablement gouvernés, c’est-à-dire dans l’intérêt des masses. Cela signifie aussi que nous avons le devoir de renforcer la cohésion de notre continent, renforcer notre capacité à agir ensemble dans le cadre d’un programme ambitieux et progressiste, qui est d’ailleurs déjà en partie à l’œuvre, grâce aux politiques menées au sein de l’OUA et de l’Union africaine. L’UA doit être consolidée en conséquence, et nous devons nous assurer que la voix de l’Afrique, notamment quand elle aborde ses propres affaires, puisse être entendue et reçue avec la considération nécessaire. Nous avons également le devoir de renforcer nos liens avec les autres pays de ce qu’on appelait le tiers monde, afin de renforcer notre capacité à peser sur le processus actuel de réorganisation des affaires mondiales.
Rien de tout cela ne nous tombera du ciel. Nous devons mobiliser et activer les forces de notre continent qui se consacrent à la transformation de l’Afrique, et qui doivent aussi être associées à notre lutte pour atteindre les objectifs que j’ai mentionnés. Nous devrons évaluer la capacité de ces forces à répondre efficacement aux défis que l’Afrique doit relever, à venir à bout de l’inertie et du legs destructeurs dont nous avons hérité de la longue période de la guerre froide. J’espère sincèrement que nous nous donnerons le temps de penser ces questions et ainsi de poser les jalons pour la mise en route d’un véritable mouvement de renaissance de l’Afrique, pleinement conscients que nous sommes d’être nos propres libérateurs.
Dans son livre Repenser la mondialisation de l’Afrique, Paul Tiyambe Zeleza écrit : « Les termes de crise et de marginalité (concernant l’Afrique), si profondément ancrés dans l’imaginaire occidental (…) sont intéressants pour les opportunités idéologiques qu’ils ouvrent à tout point de vue : à droite, ils évoquent un vœu de disparition d’un continent vu comme infréquentable pour l’humanité alors qu’à gauche ils ravivent les sympathies pour les opprimés. »•2
Je suis certain que les opprimés d’Afrique attendent que nous agissions de concert avec eux pour mettre fin à leur condition de damnés de la terre.
Thabo Mbeki
Ce texte s’inspire de l’allocution de Thabo Mbeki à l’Institute of Social Research de l’Université Makerere de Kampala, lors de la conférence « Architecture de l’Afrique dans l’après-guerre froide — au-delà des réformes internes et des interventions extérieures » en janvier 2012.
1. Henry Kissinger, Diplomacy, The Easton Press, Norwalk, Connecticut, 1994.
2. Paul Tiyambe Zeleza, Rethinking Africa’s Globalisation: Vol 1, The Intellectual Challenges, by Africa World Press, Inc.,Trenton, New Jersey &Asmara, Eritrea, 2003.
Source: géopolitique africaine
Mon, 11 Jun 2012 13:49:00 +0200
0